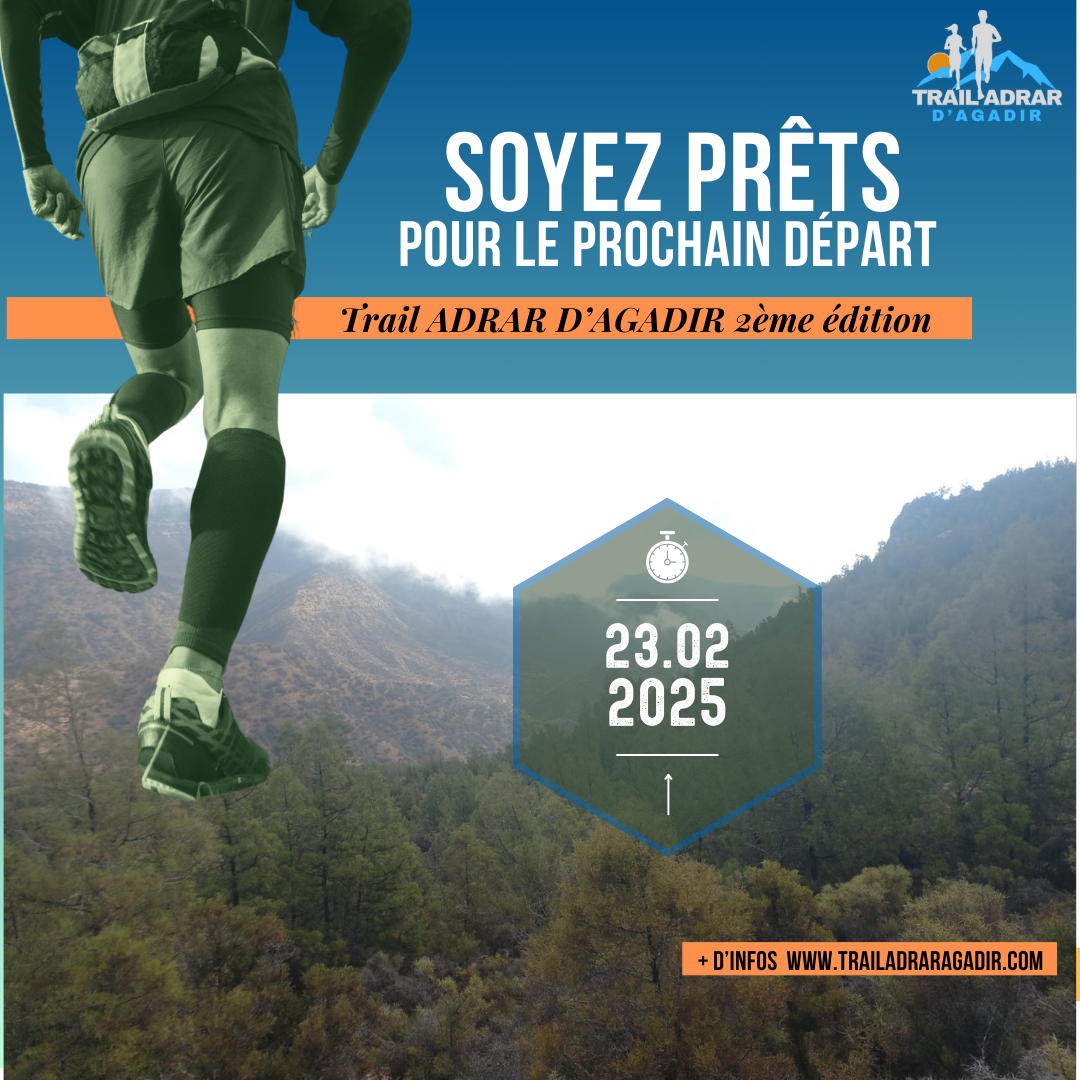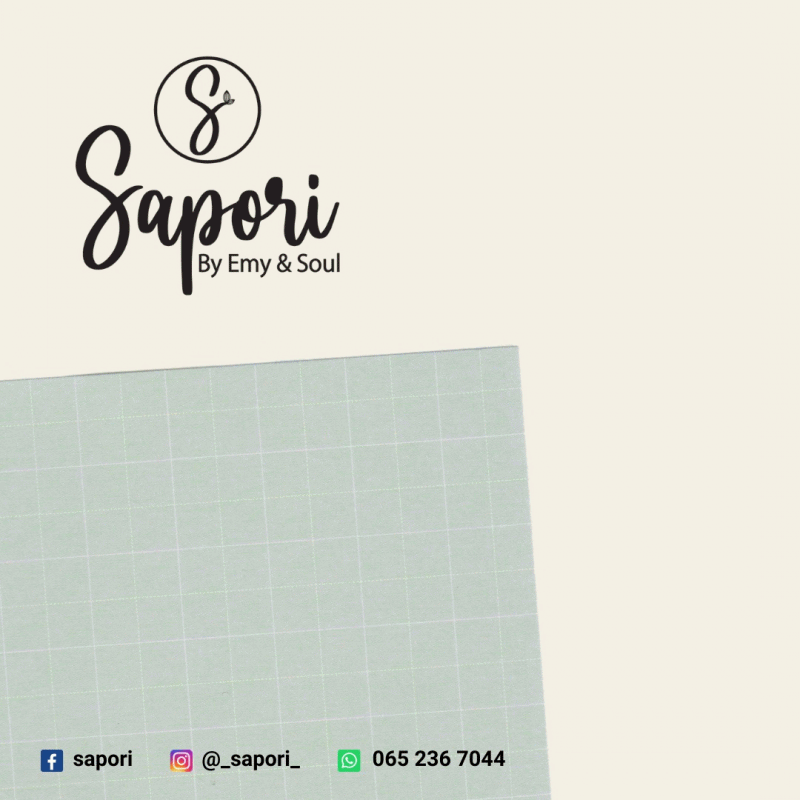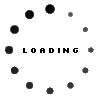Coronavirus, l’impact prévisible sur les rapports entre la société et l’agriculture

La crise issue du coronavirus est si évolutive qu’il faut se garder de conclusions hâtives. Néanmoins, on constate des tendances dans l’évolution des rapports entre la société et l’agriculture. Voici ces tendances.
L’actuelle épidémie de Covid-19 est inédite par plusieurs aspects. Il s’agit à l’évidence d’une crise majeure comme l’on en connaît une tous les dix ans environ depuis le début des années 1970 : premier choc pétrolier suivi d’une récession (1973-1974), second choc pétrolier suivi également d’un fort ralentissement économique (1979-début des années 1980), fin de la guerre froide (1989-1991), attentats du 11 septembre et explosion de la « bulle internet » (2001), crise des subprime suivie d’une récession mondiale (2008-2009).
Covid-19 : une crise multiforme
Cette crise a néanmoins des traits assez spécifiques par rapport aux crises précédentes – « chocs » pétroliers, effondrement de régimes politiques, krachs boursiers, attentat majeur – car celle-ci a plusieurs dimensions.
Il s’agit en premier lieu d’une pandémie mondiale – puisque près de 170 pays ont au moins un cas de personnes affectées par le coronavirus au sein de leur territoire –, qui a fait à ce stade beaucoup plus de victimes que les épidémies ou flambées récentes : syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) en 2003, grippe H1N1 en 2009, syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS) en 2012, Ebola en Afrique de l’Ouest en 2014 ou virus Zika en 2016.
Le confinement de populations entières sur le modèle de ce que la Chine a fait à partir du mois de janvier dans certaines villes et provinces apparaît également inédit. Avec le confinement de l’Inde à partir du 24 mars, pas moins d’un tiers de la population mondiale est désormais en quarantaine.
La troisième caractéristique de cette crise multiforme réside dans son impact économique à partir du moment où de très nombreuses économies sont à l’arrêt quasi total. On s’attend par conséquent pour 2020 à une récession mondiale sans équivalent depuis la Seconde Guerre mondiale. D’après un article publié le 24 mars dans Les Echos, les économistes tableraient ainsi sur un recul de l’ordre de 5 % du PIB de la zone euro et de la France en 2020. Bruno Le Maire, le ministre de l’Economie cité dans ce même article, explique que « cette crise, qui touche l’économie mondiale et l’économie réelle, n’est comparable […] qu’à la crise de 1929 ».
Au passage, les références fréquentes à la grippe dite « espagnole » de 1918 – Emmanuel Macron par exemple dans son adresse aux Français le 12 mars dernier déclarait que « cette épidémie qui affecte tous les continents et frappe tous les pays européens est la plus grave crise sanitaire qu’ait connu la France depuis un siècle » – et à la crise de 1929 montrent bien la gravité de ce que l’on est en train de vivre car ce sont deux catastrophes, sanitaire pour la première et économique pour la seconde, qui ont traumatisé plusieurs générations.
La dernière facette de cette crise est liée à des pénuries de produits de base, là aussi assez inédites dans les pays riches – pénurie de certains produits alimentaires et d’hygiène provoquée par les achats panique de consommateurs un peu partout dans le monde, ou de masques de protection et de gel hydroalcoolique en France – et à des craintes d’une pénurie de médicaments ou de tensions sur les prix alimentaires mondiaux exprimée par la FAO le 24 mars, qui pourrait se produire si les achats de panique de produits agricoles de base par les gros importateurs prenaient de l’ampleur, comme cela semble être actuellement le cas pour la Chine.
Quelle évolution des rapports entre société agriculteurs ?
Quel peut être l’impact de ces différentes crises (épidémie, confinement, récession économique, risque de pénuries) sur les rapports entre, d’un côté, la société française et la société civile, et de l’autre, les agriculteurs ?
Ces différentes crises suscitent beaucoup d’analyses et de débats. Deux types d’interprétations globales tendent à dominer. La première est que ces crises vont contribuer à tout changer, des relations interindividuelles, compte tenu de la persistance prévisible de différentes formes de distanciation sociale, jusqu’à la mondialisation en passant par le rôle de l’Etat, la construction européenne, le rapport à la société de consommation ou à tout ce qui vient de l’étranger. Cela correspond au concept de « Game-changer » notamment mis en avant par Bruno Le Maire.
La seconde interprétation est qu’à partir du moment où l’épidémie sera jugulée, tout devrait revenir à peu près à la normale.
Ces deux interprétations s’appliquent également aux secteurs agricole et alimentaire. Certains estiment ainsi que l’ère de l’agribashing est achevée compte tenu de la mutation de la vision de la société sur l’agriculture et le monde rural qui s’est opérée. D’autres, notamment sur les réseaux sociaux, tendent, au contraire, à redouter que les critiques à l’encontre de l’agriculture recommencent de plus belle et même se renforcent une fois la crise passée.
Alors même que nombre de nos compatriotes sont hospitalisés en soin intensif, que d’autres sont positifs et se montrent très inquiets, tout comme leurs proches, que les personnels soignants sont sur le « front » de la « guerre » contre l’épidémie dans des conditions souvent très difficiles, ou que des employés sont obligés de travailler tout en étant exposés au virus, il paraît très prématuré, et même quelque peu indécent, de tirer de quelconques enseignements de la période que l’on est en train de traverser collectivement. On peut malgré tout dresser quelques constats à ce stade.
Une société française toujours aussi fragmentée
En premier lieu, on voit bien que ces crises tendent plutôt à renforcer et à aggraver la fragmentation de la société française plutôt qu’à la résorber. Non seulement les Français ne sont pas égaux face à la maladie, mais ils ne le sont pas davantage face au confinement. On le sait, la probabilité d’avoir des complications une fois que l’on est déclaré positif au Covid-19 est plus importante pour les personnes qui ont plus de 70 ans, ou qui ont une santé fragile.
En outre, il est aussi évident que les Français sont très loin d’être dans une situation d’égalité face au confinement. On peut tout d’abord distinguer, en effet, (1) les personnes malades (diagnostiquées, hospitalisées ou en soin intensif) et leurs proches, (2) les médecins et les personnels soignants, (3) les personnes souvent en bas de l’échelle sociale qui sont dans l’obligation de travailler dans des situations où elles peuvent être exposées au virus sans nécessairement avoir de protection (facteurs, caissier(e)s de supermarché, chauffeurs-livreurs, chauffeurs de bus, policiers, employés dans les commerces qui restent ouverts, employés d’Amazon, etc.), (4) les personnes qui continuent de travailler, mais sans être exposées au virus, à l’instar de représentants de l’administration publique (qui ne sont pas en contact direct avec le public), des agriculteurs ou des chercheurs scientifiques, et (5) les personnes confinées.
Il est aussi évident que le rapport au confinement est loin d’être le même selon que les personnes concernées sont seules ou pas, âgées ou pas, qu’elles aient des enfants (qui font l’école à la maison) ou pas, qu’elles vivent dans un logement exigu (sans parler des sans-abris) ou une maison avec jardin, dans une grande agglomération, une banlieue « sensible » ou un petit village, qu’elles soient en mesure de pouvoir travailler par télétravail ou pas, qu’elles continuent de percevoir un salaire (ou une rémunération en tant que free lance) ou pas, qu’elles aient un accès internet ou pas, etc.
Le vœu de Jérôme Fourquet, l’auteur de L’Archipel français (Seuil, 2019), selon lequel « l’adversité et l’ode à nos médecins peuvent créer un sentiment de destin commun que les gens avaient perdu » semble être malheureusement pour le moment un vœu pieux.
Cela tend à signifier également que les attentes des différentes parties de la société française sur le plan alimentaire sont et restent multiples et que, pour répondre à ces attentes multiformes, la production agricole française doit s’appuyer sur diverses méthodes de production.
Une nouvelle vision de l’agriculture et de l’alimentation
Ces crises ont tout autant favorisé l’émergence d’une nouvelle vision de l’agriculture et de l’agro-alimentaire. Même si la notion même d’activité essentielle n’a pas été gravée dans le marbre, le gouvernement se refusant pour le moment à publier la liste de ces activités, l’agriculture et l’alimentaire figurent bien évidemment parmi les activités jugées essentielles, au même titre que la santé, la distribution de l’eau et de l’électricité ou encore les télécoms.
En Italie, le Premier ministre Giuseppe Conte a décidé le 22 mars d’arrêter toutes les activités de production non essentielles, celui-ci parlant à ce propos de « toute activité de production sur le territoire qui ne serait strictement nécessaire, cruciale et indispensable afin de nous garantir les biens et services essentiels ». L’alimentaire faisait bien entendu partie de ces activités essentielles au même titre que les pharmacies, les services postaux, financier et d’assurance et les transports.
Le 24 mars le ministre de l’Agriculture Didier Guillaume a même parlé sur RMC et BFMTV de la « grande armée de l’agriculture française » en enjoignant les Français à la rejoindre. Celui-ci a, en effet, appelé les « Français sans activité » à participer aux récoltes alors que le secteur agricole manque de main-d’œuvre : « rejoignez celles et ceux qui vont nous permettre de nous nourrir de façon propre, saine, durable ». Il a également invoqué le « besoin de solidarité nationale pour que nous puissions tous manger ».
On voit bien en cette période de crise que l’on en revient aux « bases », à savoir qu’« Au moins une fois dans ta vie, tu auras besoin d’un médecin, d’un notaire, d’un architecte, d’un avocat… Mais tous les jours, trois fois par jour, tu auras besoin d’un agriculteur ! », d’après une citation que l’on voit souvent reprise dans le monde agricole.
En novembre 2019, Sébastien Abis, le directeur du club Demeter, indiquait dans une tribune publiée dans L’Opinion : « Sommes-nous conscients, à chaque repas, d’avoir à nos côtés un agriculteur ? Combien d’entre nous, dans l’acte alimentaire répété plusieurs fois par jour, établissent ce lien indissociable entre le contenu de notre assiette et les travailleurs de la terre et de la mer ? » Les crises que nous sommes en train de vivre nous permettent sans aucun doute d’en prendre pleinement conscience.
Ces crises ont, en effet, également tendu à montrer qu’aux yeux d’un grand nombre de consommateurs, le principal risque lié au système alimentaire n’est pas tant le risque d’empoisonnement que le risque de pénurie. Il est évident que lors de leurs « achats panique », les consommateurs ne regardaient pas la composition des produits qu’ils se procuraient ou ne prenaient pas le temps de consulter l’application Yuka.
Cela a également amené Emmanuel Macron dans son adresse aux Français du 12 mars dernier à remettre la question de la souveraineté alimentaire au cœur de l’agenda gouvernemental : « Déléguer notre alimentation, notre protection, notre capacité à soigner, notre cadre de vie au fond à d’autres est une folie. Nous devons en reprendre le contrôle, construire plus encore que nous ne le faisons déjà une France, une Europe souveraine, une France et une Europe qui tiennent fermement leur destin en main. Les prochaines semaines et les prochains mois nécessiteront des décisions de rupture en ce sens. Je les assumerai. »
Ces différentes crises ont semble-t-il mis au jour un certain nombre de vulnérabilités. Il est assez évident que la quête d’une meilleure souveraineté alimentaire devrait devenir une priorité à l’avenir. Le rapport d’information du sénateur Laurent Duplomb sur la place de l’agriculture française sur les marchés mondiaux présenté en mai 2019 indiquait à ce propos que « la France a recours massivement à l’importation de produits agricoles et alimentaires dont une partie importante pourrait être produire sur son territoire » et que « les importations couvrent une part de plus en plus importante de l’alimentation des Français » : cela représente près d’un fruit et légumes sur deux consommés en France, plus d’un tiers de la consommation de volailles et un quart de la consommation de porc.
La campagne comme zone de refuge
Le début de la période de confinement a été également marqué par un exode assez notable de citadins, en particulier en provenance de la région parisienne, en direction de la campagne. On a pu observer le même phénomène dans d’autres pays, notamment en Espagne. La campagne est ainsi vue comme une sorte de lieu de refuge en situation de crise.
Or, si l’on suit ce que dit le sociologue Jean Viard, cette situation est loin d’être nouvelle. Quitter la ville pour la campagne en période de crise est, en effet, selon lui, une « pratique [qui] existe depuis toujours. Les élites romaines disposaient aussi des thermes à une heure de cheval, les aristocrates avaient des châteaux et les bourgeois du XIXe siècle possédaient des villas… La ville a toujours été perçue comme un lieu qui sent mauvais, avec des maladies l’été et des émeutes. Le modèle des populations aisées qui vont se mettre à l’abri à la campagne est donc classique ». Il en conclut que « se réfugier à la campagne est un réflexe traditionnel de protection. On se dit toujours qu’à la campagne on va mieux se nourrir et que cela sera moins dangereux. »
Plus largement, si l’on se réfère à ce que dit le sociologue Clément Prévitali, on peut considérer que « la représentation commune que l’on a de la vie à la campagne correspond à celle d’un havre de paix. La campagne est chargée de représentations spécifiques qui font d’elle, contrairement à la ville, un espace sain dans lequel ses habitants sont heureux. Ce serait un milieu où il fait bon vivre, sentiment partagé par tous (urbains et ruraux), excepté par les agriculteurs qui possèdent un rapport particulier à cette espace. En privilégiant le mode d’habiter rural et en représentant, dans l’imaginaire collectif, un territoire où l’on peut vivre modestement avec les avantages d’un loyer bas, d’un jardin potager et des pratiques de nature gratuites, ce mythe du paradis perdu possède une attractivité importante auprès des classes populaires mais aussi des catégories supérieures. L’une, pour des conditions économiques favorables, comme l’autre, pour le bon air, aspirent à un « mieux vivre ». »
En situation de crise et de peurs collectives, la production agricole, le rôle de l’agriculteur et de l’agriculture, la souveraineté alimentaire et la campagne sont revalorisées, tout comme, de façon plus générale, le rôle de l’Etat, la souveraineté nationale, le keynésianisme ou la fermeture des frontières. On peut néanmoins se demander si, une fois sorti de la crise, on ne risque pas de retomber dans les travers passés.
Un point de vue d’académiciens de l’Académie d’agriculture intitulé Production agricole et épidémie de Covid-19, retour aux fondamentaux ? et publié en mars se montre plutôt sceptique de ce point de vue : « depuis le début de cette crise, il apparaît en France que les actuelles défiances alimentaires ont été oubliées, certainement pas au-delà de la période de confinement. Il y a à peine deux mois, l’aliment était perçu par beaucoup comme porteur d’un risque sanitaire réel ou imaginé. Il s’agit bien d’un retour, provisoire, mais quelque peu irrationnel aussi, à la peur ancestrale de manquer qui avait disparu depuis un demi-siècle ». Il en conclut d’ailleurs qu’« il reste à espérer qu’une fois l’urgence sanitaire passée, ceux-là mêmes qui ont rempli leur chariot, avec avidité lors de cette crise, ne se retrouvent pas dans les rangs de ceux qui critiquent et dénigrent l’agriculture et les agriculteurs malgré les efforts de ces derniers pour se conformer aux normes exigées par la société civile depuis plus de 20 ans ».
L’évolution du rapport à la science
Il convient tout autant de se montrer prudent quant à l’impact de l’épidémie actuelle de coronavirus sur la perception de la science. On pourrait penser à première vue que celle-ci peut amener à penser que la nature n’est pas aussi bonne que cela et que c’est grâce aux avancées scientifiques que l’on pourra trouver un traitement et ensuite un vaccin, et par conséquent que, dans la perception du rapport homme-nature, la situation peut quelque peu se rééquilibrer au profit du premier souvent accusé d’être nuisible à la seconde.
En même temps, on voit bien que les fake news et les théories conspirationnistes tendent à pulluler à propos de cette épidémie et que, face à l’immense espoir d’avoir un traitement qui soit efficace, avec la chloroquine, on peut être tenté, comme le font certains, de se passer de tout protocole scientifique.
Des voix se sont également élevées pour expliquer que le virus était tout simplement le résultat des activités humaines sur la nature. Ce fut notamment le cas de Nicolas Hulot qui a affirmé qu’avec cette épidémie, « nous recevons une sorte d’ultimatum de la nature », ou de Rémi Salomon, le président de la commission médicale d’établissement de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP), pour qui « cette pandémie est le fruit de ce que l’homme fait de la planète ».
L’expérience collective de la décroissance
Les principaux pourfendeurs de l’agriculture française, et plus précisément du mode de production conventionnel, tendent à converger autour de l’idée d’une grande transition écologique de nature décroissante en vue de lutter contre le changement climatique et donc d’une transition agroécologique, plutôt d’ailleurs au sens d’une « agroécologie paysanne ».
Or, à leurs yeux, l’expérience du confinement est tout d’abord la preuve de l’existence a contrario d’un lien entre, d’une part, activité économique et, d’autre part, émissions de CO2 et pollution. Elle peut même constituer une sorte de « précédent » à partir du moment où le volontarisme politique qui a conduit à l’arrêt des activités économiques et des déplacements via des véhicules à moteur au nom de la lutte contre la propagation du coronavirus a eu un impact positif en termes d’émissions de gaz à effet de serre, de pollution atmosphérique ou de l’eau (par exemple à Venise). Le chercheur François Gemenne explique ainsi à propos de la Chine que « le nombre de vies épargnées grâce à la baisse de la pollution atmosphérique est plus important que le nombre de morts causés par le coronavirus ». Un autre chercheur Marshall Burke estime lui aussi que « la réduction de la pollution en Chine a probablement sauvé vingt fois plus de vies que celles qui ont été perdues en raison du virus ».
Cette expérience de décroissance « réelle » peut donc servir, de leur point de vue, de « jurisprudence » : si on a pu le faire pour le coronavirus, il n’y a aucune raison que l’on ne le fasse pas pour le réchauffement climatique. Corinne Le Quéré, la présidente du Haut conseil pour le climat (HCC), expliquait ainsi le 11 mars dans une intervention devant le Conseil économique, social et environnemental (Cese), que « sans pousser l’analogie trop loin, on voit bien avec l’actuelle crise sanitaire liée au coronavirus la capacité des gouvernements à agir dans l’urgence pour l’intérêt général. Des plans d’actions sont développés sur la base de données scientifiques et actualisées. Une réponse rapide est coordonnée à l’international, soutenue par les individus et les entreprises. […] Des sommes importantes sont débloquées au niveau national ou européen pour aider les entreprises à passer le cap. On sait donc faire. »
Il est par conséquent évident que les organisations de la société civile (OSC) vont établir une forte pression pour appliquer une forme de confinement « doux » et adapté pour répondre à l’urgence climatique comme cela a été fait pour répondre à l’urgence sanitaire.
C’est ce que prônait de façon implicite fin 2018 un rapport publié par le cabinet B & L évolution, Comment s’aligner sur une trajectoire compatible avec les 1,5°C ? Celui-ci estimait que, pour parvenir à respecter une telle trajectoire, il fallait en particulier arrêter la construction de maisons individuelles, diviser par deux la consommation d’électricité par personne, le nombre de véhicules en circulation, diviser par trois la consommation de viande et de produits laitiers ou des flux de données échangées, interdire les voitures thermiques en centre urbain en 2024, généraliser le télétravail deux jours par semaine à partir de 2025, relocaliser la production, supprimer les vols intérieurs ou encore interdire les vols hors Europe non justifiés. Les auteurs du rapport en concluent que « c’est une véritable économie de guerre qu’il faut mettre en place, une économie de rationnement, d’efforts intenses qui nous sort de notre monde de confort ».
« Il faut aider les paysans mais… »
En définitive, on peut supposer, du moins à ce stade, que le rapprochement qui s’est quelque peu opéré ces dernières années entre des agriculteurs, qui ont fait évoluer à la fois leurs pratiques et leur communication, et une partie des Français devrait se poursuivre. En revanche, on pourrait aussi assister à un renforcement de l’activisme des OSC en faveur d’une grande transition pour lutter contre le changement climatique. On le voit, par exemple, avec la réaction du mouvement des « coquelicots » suite à l’appel de Didier Guillaume, via un communiqué intitulé « Oui il faut aider les paysans, mais » : « nous refusons l’opération amnésie et amnistie en cours. On n’efface pas un désastre en appliquant une couche de peinture dessus, fût-elle verte ».
Le risque est par conséquent que le débat idéologique autour des enjeux agricoles reste toujours aussi vif, d’autant que chacune des parties prenantes peut avoir le sentiment d’avoir désormais en sa possession un argument imparable en mettant l’accent soit (1) sur le risque d’une pénurie alimentaire, soit (2) sur le précédent d’une expérience de décroissance qui a eu un impact positif sur l’environnement.